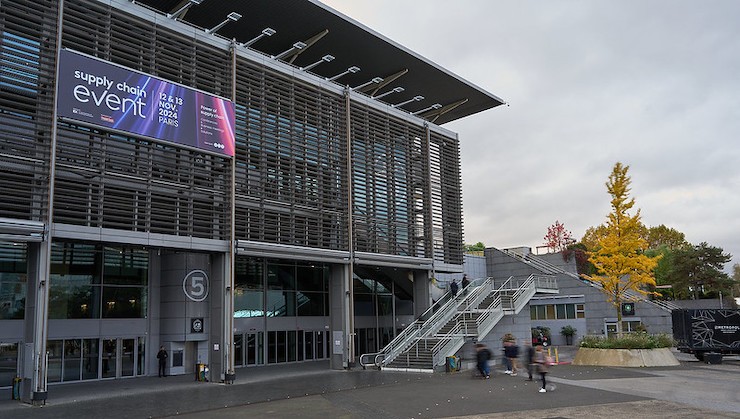Transversal
Décarbonation et stratégie d’adaptation : une double injonction pour de nouvelles chaînes de valeur
Une tribune signée par Yann de Feraudy, président de France Supply Chain by Aslog et vice-président du conseil d'administration de l'European Logistics Association (ELA).

©
faithie via stock.adobe.com
Dans un monde secoué par les conflits, la volatilité géopolitique et la pression réglementaire, la chaîne logistique n’a jamais été autant questionnée et l’urgence climatique passe parfois en seconde priorité. Face à ces bouleversements, les supply chains managers doivent conjuguer performance immédiate, responsabilité sociétale et respect de l’environnement tout en réinventant leurs modèles.
Dans ce contexte, la réussite ne peut plus se mesurer exclusivement à la rapidité d’exécution ou à la compression des coûts, mais à la capacité d’anticiper les crises, gérer les aléas tout en tenant compte des enjeux planétaires, humains et normatifs, afin de dessiner des chaînes de valeur réellement résilientes et soutenables.
Performance court terme : impératif, mais insuffisant
Je l’ai déjà écrit dans ces colonnes, historiquement, la supply chain s’est imposée comme la championne de l’optimisation des flux et des coûts, au service immédiat de la performance opérationnelle et financière en allant chercher les coûts les plus bas, partout sur la planète.
Mais cette approche, poursuivie depuis plus de 40 ans dans le cadre d’une mondialisation « heureuse » montre ses limites dès lors qu’elle ignore : les externalités négatives (consommation d’énergie et rejets de CO₂) ou les risques systémiques liés au climat, à l’instabilité des marchés et aux crises géopolitiques qui viennent fragmenter le monde, laissant apparaître de nouvelles fragilités et des « dépendances stratégiques ».
Cette tension entre le court et le long terme génère une intégration difficile de la RSE, longtemps perçue comme sujet d’expert, hors du cœur stratégique de l’entreprise. Un constat partagé par de nombreux conseils d’administration, où la diversité des attentes (dirigeants, banquiers, parties prenantes) complexifie la gouvernance des indicateurs extra-financiers.
Respect de la planète : actionner les leviers de décarbonation
La supply chain concentre plus de 80 % de l’empreinte carbone des entreprises selon France Supply Chain, mais aussi plus de 40 % de l’EBITDA, bien au-delà de l’image d’Épinal de la logistique.
Face à ce défi, le premier axe incontournable est la décarbonation à la source : produire là où l’on vend, limiter les flux inutiles, sélectionner et accompagner les fournisseurs vers des pratiques compatibles avec le respect des limites planétaires (Carbon Disclosure Project - CDP, Science Based Targets initiative - SBTi).
À la pression écologique s’ajoute l’urgence d’un modèle porteur de souveraineté économique, notamment face à la fragmentation géopolitique. Il y a là une nécessité de « massifier la transition » avec tous les acteurs, des PME aux géants du CAC40, pour éviter que la transformation durable ne reste l’apanage des mieux dotés.
La montée en puissance des filières locales, l’appui à l’innovation et la sécurisation des meilleurs sourcings ou encore l’intégration de programmes de durabilité de tous les fournisseurs d’une supply chain constituent des leviers essentiels.
La souveraineté industrielle — à rebours du dogme d’une mondialisation débridée — redevient ainsi un pilier stratégique, pour répondre aux nouvelles dépendances (matières, énergie, technologie) et anticiper des disruptions majeures, inéluctables avec l’accélération du dérèglement climatique.
Reporting, normes et indicateurs : outils de crédibilité et de transformation
« Ce qui se mesure est managé », disait Peter Drucker. Les acteurs s’accordent pour dire que les indicateurs sont utiles. Leur normalisation l’est aussi, ne serait-ce que pour éviter le greenwashing et pouvoir se comparer.
La CSRD, pivot européen, devait entraîner les grandes entreprises et progressivement leur écosystème. Nous verrons ce qu’il en restera. Une chose est certaine, la majorité des acteurs qui ont produit leur premier rapport de durabilité ne souhaite pas revenir en arrière.
Mais « l’échec de la CSRD » à aligner des besoins multiples et à apporter des indicateurs pertinents pour tous doit nous conduire vers une « normalisation intelligente » : simplifier l’accès aux données sans sacrifier l’ambition, pour embarquer PME, ETI et même les acteurs non européens.
Les exigences de preuve sur le scope 3, la mesure de l’impact réel (et non seulement des intentions) ou les trajectoires validées SBTi (Science Based Targets initiative) nourrissent un dialogue nouveau avec l’ensemble des parties prenantes.
En effet, la lutte contre le greenwashing constitue aussi un enjeu central. Les outils d’évaluation (plateformes d’exposition au risque climatique, standards CDB et SBTi pour les fournisseurs) doivent intégrer les doubles dimensions de la décarbonation et de la stratégie d’adaptation, tout en restant transparents et communicables. Les nouveaux modèles d’indicateurs doivent être conçus pour éviter la simple conformité de façade, et nourrir un pilotage stratégique authentique de la transition.
Vers un modèle de prospérité régénérative ?
Les rapports sur le climat GIEC, la situation des océans… montrent tous que l’objectif des accords de Paris ne sera pas tenu. Ce n’est pas +1,5 degré, mais sans doute +2, voire +3 degrés. Il est important de parler de transition, mais plus urgent de définir des stratégies d’adaptation car les événements climatiques seront plus violents et plus fréquents ; il en va de la pérennité des entreprises et de leurs actifs. Voilà un premier pas pour réconcilier court terme (adaptation) et long terme (atténuation).
Justement, dans une vision long terme à 2050, deux thèmes reviennent de plus en plus souvent :
1. Au-delà de la décarbonation, le bilan matière… ou, comment intégrer les limites planétaires sur les ressources ? Réflexion qui conduit à faire émerger des modèles d’économie circulaire.
2. « L’économie de la fonctionnalité », qui en est l’aboutissement, réinvente l’offre et préfigure une économie circulaire, centrée sur l’usage, la sobriété et la circularité. Des modèles mis en place par des géants comme Michelin (et depuis des années) ou des start-ups montrent des exemples prometteurs et profitables de telles offres. Encore faut-il mettre en place les supply chains circulaires qui vont les aider dans leur performance.
Héritages et légitimité des chaînes de valeur
Le fil « vert » de Produrable 2025 est « Héritages : préserver, restaurer, transmettre ». Nous sommes donc des héritiers, la terre est même notre premier et commun héritage à tous.
Dans tout héritage il faut commencer par recevoir, car on ne peut pas changer l’héritage, et dans notre cas nous héritons d’un monde très « gourmand » qui ne reconnaît pas de limite à son développement.
Il faut parfois trier, car il y a des choses dont on ne veut pas, ou dont on ne veut plus… Autant on peut assumer certaines choses du passé, autant on n’est pas obligé de cautionner… Malgré les coups de mentons outre-Atlantique, beaucoup d’initiatives sont déjà en cours et apportent des résultats tangibles à des leaders mondiaux.
L’enjeu est d’emmener à leur suite tous les acteurs, y compris les plus petites entreprises. C’est ici que le concept de supply chain prend tout son sens : tous les maillons doivent être au diapason. Nous pourrons ainsi transmettre des modèles économiques plus vertueux aux générations futures.